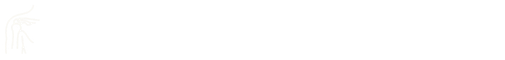Réparation de la Coiffe des Rotateurs
Chaque année, environ 50 000 réparations de la coiffe des rotateurs sont pratiquées en France. Cette chirurgie concerne principalement des adultes d’âge moyen ou avancé, souvent actifs, qui souffrent d’une rupture partielle ou complète des tendons assurant le bon fonctionnement de l’épaule. Cet article vous explique en détail l’objectif, le déroulement, les indications et les suites opératoires de cette intervention courante, mais techniquement exigeante.
L’auteur de l’article
Docteur Mikaël CHELLI
Chirurgien orthopédiste, avec une hyperspécialisation en chirurgie de l’épaule et du coude
Qu’est-ce que la coiffe des rotateurs ?
La coiffe des rotateurs est un ensemble de quatre tendons qui enveloppent la tête de l’humérus, l’os du bras, pour stabiliser l’articulation de l’épaule et permettre les mouvements. Ces tendons sont :
Le supra-épineux (le plus fréquemment lésé)
L’infra-épineux
Le subscapulaire
Le petit rond
Le tendon du long biceps n’appartient pas directement à la coiffe mais est souvent impliqué dans les douleurs associées aux lésions de la coiffe.
Pourquoi opérer une rupture de la coiffe ?
Lorsque la rupture est symptomatique (douleurs, perte de force, perte de mobilité), notamment chez un patient actif ou avec des objectifs fonctionnels élevés, une réparation est envisagée. Le but est de réinsérer le tendon rompu sur son insertion osseuse d’origine (le trochiter), afin de rétablir la continuité anatomique et fonctionnelle de la coiffe.
Cas où la chirurgie est souvent indiquée :
Rupture traumatique chez un adulte jeune ou actif
Échec du traitement médical bien conduit (rééducation, infiltrations)
Rupture massive mais réparable
Altération progressive de la force ou de la mobilité
Comment se déroule l’intervention ?
La réparation est réalisée au bloc opératoire, le plus souvent sous arthroscopie, une technique mini-invasive utilisant une caméra et de petits instruments introduits par des incisions de quelques millimètres.
Étapes clés de la chirurgie :
Libération du tendon rompu : on réalise une adhésiolyse, une capsulotomie juxta-glénoïdienne, et une ouverture de l’intervalle des rotateurs, pour mobiliser le tendon et réduire les tensions.
Préparation de l’os (le trochiter) : on le "rafraîchit" pour favoriser la cicatrisation.
Pose d’ancres : de petits implants sont insérés dans l’os, permettant de passer des fils dans le tendon.
Sutures tendineuses : le tendon est fixé solidement sur l’os par des points de suture.
Le but est d’obtenir une réparation sans tension, facteur clé de la cicatrisation tendineuse.
Gestes associés fréquents :
Acromioplastie (résection de l’acromion pour éviter les conflits)
Ténodèse ou ténotomie du long biceps (réinsertion du tendon dans l’humérus)
Résection de la clavicule distale (en cas d’arthropathie acromio-claviculaire), plus rarement
Et si la coiffe n’est pas réparable ?
Lorsque le tendon est trop rétracté ou que le muscle est infiltré de graisse, une réparation n’est plus possible. D’autres solutions chirurgicales sont alors envisagées :
Ténotomie ou ténodèse isolée du biceps
Prothèse inversée d’épaule, en particulier chez les patients âgés avec rupture massive irréparable
Transfert tendineux, chez les patients plus jeunes, pour compenser une fonction motrice perdue (ex : transfert du grand dorsal ou du trapèze inférieur)
Résultats attendus
La majorité des patients présentent une nette amélioration de la douleur et de la fonction. Cependant, le taux de cicatrisation complète varie selon plusieurs facteurs :
Taille de la rupture
Délamination tendineuse (déchirure en feuillets)
Infiltration graisseuse musculaire
Âge du patient
Dans l’étude de Boileau et al. (2019), le taux de cicatrisation complète était de 78 % en l’absence de délamination et seulement de 57 % en présence de délamination, soulignant l’importance de cette lésion intra-tendineuse pour le pronostic.
Suites opératoires
Hospitalisation
L’intervention est réalisée en ambulatoire dans la majorité des cas. Une nuit d’hospitalisation peut être nécessaire selon les comorbidités ou les contraintes sociales.
Immobilisation
Une attelle d’épaule est généralement portée pendant 4 à 6 semaines. La position d’immobilisation varie en fonction des objectifs de votre chirurgie et des tendons réparés :
Coude-au-corps (rarement utilisé dans notre pratique)
En rotation neutre, c’est-à-dire avec la main devant
En abduction, avec le bras écarté du corps, en cas de large rupture
Rééducation
Le protocole vous est fourni en post-opératoire mais le protocole de rééducation est généralement le suivant :
Auto-rééducation commencée au 1er jour post-opératoire (ou au 21ème jour en cas d’attelle en abduction)
Kinésithérapie active et passive entre la 4e et la 6e semaine
Renforcement musculaire à partir du 3ème mois
Durée totale : 4 à 6 mois, selon les cas
Chaque cas est unique et les objectifs de rééducation sont adaptés au fur et à mesure par votre chirurgien et votre kinésithérapeute.
Complications possibles
Bien que le taux global de satisfaction soit élevé, certaines complications peuvent survenir :
Raideur articulaire
Rupture itérative du tendon ou non-cicatrisation
Algodystrophie
Infection (rare)
Douleurs résiduelles du biceps
La re-rupture n’est pas toujours synonyme d’échec clinique : certains patients restent très satisfaits malgré une cicatrisation incomplète.
Conclusion
La réparation de la coiffe des rotateurs est une intervention sûre et efficace, à condition de bien sélectionner les patients et de suivre un protocole rigoureux. Les progrès techniques (arthroscopie, ancres résorbables, double feuillet, etc.) ont considérablement amélioré les résultats fonctionnels. Cependant, la qualité de la cicatrisation dépend fortement de l’anatomie initiale, du terrain et de l’adhérence aux consignes post-opératoires.
Docteur Chelli
RDV en ligne sur